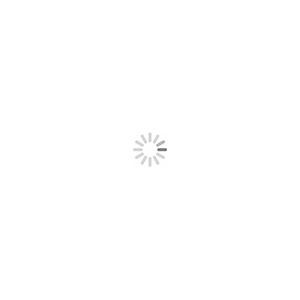Yobouet Lazare, ancien maire de Diabo (commune qu’il a dirigée pendant 10 ans), est l’un des doyens des cadres baoulé. Il rappelle l’origine des retrouvailles de la période de Pâques baptisées Paquinou et explique leur influence sur le développement des villages baoulé.
En Côte d’Ivoire, quand la fête de Pâques arrive, tous les regards se tournent vers le peuple Baoulé qui a donné, à cette célébration chrétienne, une connotation culturelle et traditionnelle appelée Paquinou. Quelle est l’histoire de cette appellation ?
Je voudrais d’abord vous dire que le mot Paquinou ne vient pas des Baoulé. C’est une expression qui était employée par ceux qui allaient dans leurs villages pendant la période de Pâques. Quand ils parlaient entre eux, ils disaient en Baoulé : « Yé Sou Kô Di Pâques » Ce qui signifie en français : « On s’en va faire la fête de Pâques.» L’expression Paquinou en français ne me plaît pas beaucoup parce que ce n’est qu’une conjugaison qui signifie : « On s’en va à Pâques chez nous.» Pour moi, il fallait dire simplement Pâques. En effet, l’expression Paquinou signifie ‘’pendant la fête de Pâques’’ Ainsi, on pourrait dire : «Paquinou, nous avons beaucoup dansé.» Comme l’expression a été acceptée par tout le monde, on la laisse courir. Sinon, je pense qu’elle n’a pas un sens particulier. Et c’est l’imagerie populaire qui, au fur à mesure, a utilisé cette expression pour désigner la fête de Pâques. Paquinou n’est donc pas un terme créé par les Baoulé pour désigner la fête de Pâques, c’est plutôt un choix de l’extérieur qui l’a fait par abus de langage. Nous l’acceptons.
Comme vous l’avez dit, l’expression Paquinou a été employée par des Baoulé qui allaient célébrer Pâques chez eux. A quand remonte le début de ces voyages ?
A Pâques, il y a un long week-end. Mais, ce n’est pas le seul long week-end. Il y a le long week-end de Pentecôte, etc. Sauf que la fête de Pentecôte se situe en pleine période culturale. A Pâques, nous sommes encore un peu dans la saison sèche. Ce sont les vacances des paysans. Que ce soient ceux restés dans nos villages, ou ceux qui exercent dans les plantations de café-cacao en zone forestière, à l’extérieur de leur terroir. Il n’y a pas de travaux champêtres, ou très peu. Ils peuvent se donner un petit temps de vacances. Au minimum un mois qu’ils vont passer au village. En période de Pâques, les élèves et étudiants sont également en vacances pour une ou deux semaines. Les parents peuvent donc aller au village avec leurs enfants. Et comme c’est un long week-end, tous ceux qui travaillent dans les villes, fonctionnaires ou ouvriers, ont la possibilité d’aller au village. C’est la période idéale pour tous les ressortissants de chacun de nos villages de pouvoir se rendre chez eux et rendre visite aux parents. Puisque nous nous retrouvons, c’est aussi l’occasion d’échanger. C’est l’occasion quelquefois de réveiller certaines funérailles et de les achever. Voilà l’origine de cet engouement des Baoulé autour de la Pâques.
A partir de quelle année, ces mouvements ont-ils pris de l’ampleur ?
Cela remonte aux 30 dernières années. Mais, le phénomène existait bien avant. Les jeunes de nos villages allaient souvent en zone forestière pour y jouer le rôle d’ouvriers agricoles. Ils allaient pour des contrats qu’on appelait ‘’6 mois’’. Souvent, cela durait un peu plus que 6 mois, mais on l’appelait ainsi. Dès que les pluies commençaient, ils partaient travailler dans les champs des propriétaires de plantations. Vers le mois de decembre, après la récolte et la vente du café et du cacao, ils étaient payés et ils rentraient au village, pour ne revenir en zone forestière qu’à la prochaine saison des pluies, c’est-à-dire vers mai-juin. A force d’aller dans les zones forestières, beaucoup ont fini par obtenir des portions de terre pour créer leur propre plantation. C’est ainsi que beaucoup de nos parents ont pu avoir quelques hectares de plantation dans les zones forestières. Dès lors qu’ils ne sont plus de simples ouvriers agricoles et qu’ils sont devenus propriétaires de plantations, ils ne vont plus en zone forestière pour 6 mois. Leurs responsabilités s’étant accrues, ils restent dans leurs plantations. Ils ne viennent plus au village après la vente du cacao ou le payement de leurs salaires, mais au moment où ils savent que le plus grand nombre de ressortissants du village peut être là. Ce mouvement a pris de l’ampleur petit à petit et a explosé durant les 30 dernières années pour les raisons que j’ai citées plus haut.
Ce phénomène a-t-il sa racine dans une zone précise du pays baoulé, ou est-il né de façon générale ?
Il est né de façon générale parce que c’est de façon générale que ce phénomène s’est observé. Mais, si on veut parler de précurseurs, on citera surtout les Baoulé qui sont en zone de savane. C’est-à-dire la région de Bouaké, de Béoumi, etc. Quand je parle de la région de Bouaké, je parle de Diabo, Botro, Bodokro, etc. Pourquoi ? Parce que Sakassou, c’est déjà à la lisière de la forêt. Eux, ils créaient leurs plantations sur place. Yamoussoukro, c’est en pleine forêt. Eux non plus ne bougeaient pas beaucoup pour aller monnayer leurs talents d’agriculteurs ailleurs. Pareil pour M’Bahiakro, Daoukro, Dimbokro, et autres. Il n’y a que nous, ressortissants de la zone de savane, qui bougions beaucoup.
Le contenu de ces retrouvailles a-t-il été toujours celui qu’on connaît, aujourd’hui ?
Au départ, c’étaient de simples retrouvailles et c’est l’aspect festif qui était privilégié. Mais au fur et à mesure que les cadres de ces régions ont commencé à émerger, ils se sont sentis dans l’obligation de conduire leurs villages à un mieux- être. Ils devaient pour cela initier des rencontres, lancer des cotisations. L’Etat, à l’époque, avec les Fonds régionaux d’aménagements ruraux(Frar) aidait les populations à s’équiper en dispensaires, en écoles, centres culturels, etc. Pour amener les populations à montrer leur volonté d’accueillir ces infrastructures, l’Etat leur demandait une petite contribution. Et c’est à partir de ces réunions de Pâques, qu’ont été initiées les cotisations pour faire face à ces dépenses pour des équipements collectifs. Mais, petit à petit, au-delà des équipements de l’Etat, l’on a commencé à penser à la restructuration, la reconstruction et la modernisation des villages. D’où les mutuelles de développement qui ont permis de construire des villages.
Faut-il en déduire que des villages baoulé doivent leur développement aux retrouvailles de Paquinou ?
On ne peut pas dire que cela vient spécifiquement de ces retrouvailles. L’évolution du monde et du pays a été elle-même à la base de ce développement. Avant, nous étions heureux de retrouver dans nos villages des cases en banco, ou, quelquefois, des cases rondes. Ce n’est pas parce qu’il y a des retrouvailles qu’on a senti la nécessité de construire des villages avec des maisons alignées et avec les rues. C’est l’évolution elle-même qui a permis cela. Mais comment allait-on le faire ? C’est à ce niveau que les retrouvailles ont joué un rôle. Elles ont contribué à permettre la réalisation de ce développement.
Pouvez-vous citer quelques exemples de grands projets favorisés par les retrouvailles de Paquinou ?
Chez moi à N’Doumoukro, (sous-préfecture de Diabo) le village était bloqué aux confins d’une forêt clairière. La route interurbaine Bouaké-Mankono en passant par Botro passait par-là. Mais, pour passer du côté droit de la route au côté gauche, où nous avons le nouveau village avec des rues tracées, il a fallu ces retrouvailles qui ont créé des liens de solidarité entre les fils et filles du village. Cela a suscité une espèce de compétition entre les différentes strates des populations. Quand on arrivait, on disait : ceux qui viennent de la ville ont cotisé 2.000.000 ou 3.000.000 de Fcfa. Et quelquefois, les paysans qui étaient venus avec un peu moins que cela, c’est-à-dire un 1,5 million ou 2.000.000 millions, disaient : cette année, vous nous avez battus, mais, l’année prochaine, nous allons vous battre. Cela a permis de réaliser beaucoup de projets. C’est valable aussi bien pour N’Doumoukro que pour beaucoup d’autres villages.
Pouvez-vous citer d’autres exemples ?
Des villages éparpillés sur des périmètres de moins de quelques km ont décidé de se regrouper. Tout cela a été favorisé par ces retrouvailles et les concertations qu’elles permettaient. Elles ont accentué la solidarité entre tous les fils de ces villages qui se sont regroupés. Cela donne aujourd’hui de beaux villages. Je peux citer l’exemple de Andokékrénou qui est devenu une sous-préfecture dans la zone de Béoumi. Avant, l’agglomération de Diabo, elle-même, ne comptait que trois villages contigus. Mais aujourd’hui, Diabo, grâce à la solidarité et au regroupement, compte 7 à 8 villages qui forment la ville de Diabo. C’est comme la ville d’Abidjan qui est composée d’Adjamé, de l’ancien village d’Anoumabo devenu Treichville, des villages de Port-Bouët etc. A la différence qu’Abidjan étant la capitale, l’évolution n’a pas été la même qu’à Diabo. Abidjan, c’est la capitale, l’Etat y a donc fait beaucoup d’investissements.
Cette solidarité a-t-elle contribué à la promotion des cadres Baoulé ?
L’exemple que je connais le mieux, c’est celui de Diabo et du peuple Gblo auquel j’appartiens. Nous avons pensé que si nous autres avons relativement réussi à aller loin dans les études, c’est grâce au soutien des parents. Dans notre devoir de reconnaissance, nous avions le devoir de soutenir aussi nos jeunes frères. A l’époque, j’organisais, chaque année, à mon domicile (Cocody-Deux Plateaux), une rencontre avec l’ensemble des étudiants Gblo. On faisait le point pour savoir à quel niveau chacun était dans les études. Et, on se battait pour parfaire la formation de ceux qui étaient en passe de terminer. A moi-même, le président Houphouet avait dit à mon temps : « tu as une licence, mais la licence, ce n’est rien. Il faut qu’on te forme. Tu es économiste, il faut que tu intègres l’administration au niveau le plus élevé.» C’est ainsi que j’ai été envoyé en formation en France et aux Etats-Unis. Donc, à notre tour, nous soutenions nos jeunes frères et nous les aidions à évoluer. Ils sont venus plus tard s’ajouter à nous pour grossir les cotisations. Tout cela a été permis par ces retrouvailles que je considère comme le point de départ de la création de la solidarité dans nos villages, et même en ville.
Ces retrouvailles ont-elles contribué à des rapprochements entre plusieurs cantons pour des projets régionaux ?
Aujourd’hui, je peux vous répondre par non. Cela ne signifie pas que l’idée n’a pas existé et n’existe pas. Jusqu’à la date d’aujourd’hui, ce rapprochement se fait au niveau festif. Par exemple, tel canton dit : cette année, nous célébrons la Pâques de telle manière et il invite les cantons voisins qui envoient des délégations. L’idée de votre question fait son chemin. Sous la houlette d’un de nos cadres, plus jeune que nous, Alain Caucautrey, il y a un grand mouvement qui est en train de se créer au niveau du canton qu’on appelle les Allandjra. C’est un mouvement qui va soutenir le développement de l’ensemble de cette zone. C’est une zone qui part de la lisière de Bouaké jusqu’au fleuve Bandama. C’est une grande zone où on peut réaliser de nombreux projets. Des projets agro-pastoraux, de cultures industrielles à grandes échelles sont en train d’être cogités. Votre question n’est donc pas innocente.
Depuis quelques années, on constate une baisse d’engouement autour du Paquinou. Cela n’a-t-il pas freiné le développement des villages qui profitaient de ces retrouvailles ?
Effectivement, il y a une baisse d’engouement due à la crise. Or, un Baoulé qui passe la Pâques hors de sa zone ne fête pas du tout. Le jour de Pâques passe comme un jour ordinaire. Aujourd’hui, la situation s’est un peu améliorée. Mais, il y a deux ans encore, quand les gens partaient de Soubré par exemple, à destination de Diabo, ils ne dépensaient pas moins de 15.000 Fcfa ou 20.000 Fcfa sur le chemin. Pour un voyage qu’ils faisaient d’habitude en 3 ou 4 heures, il leur fallait toute une journée. Ils partaient de Soubré le matin, pour n’arriver dans leur village que la nuit, vers 21 heures. Souvent, lorsqu’ils arrivent à Bouaké la nuit, les transporteurs leur disent qu’ils ne font plus de voyage vers Diabo parce qu’il y a des ex-rebelles sur la route. Ils sont obligés de passer la nuit à Bouaké, ce qu’ils n’avaient pas prévu. Il y a aussi le fait qu’à cause de la crise, tout a augmenté. Il est arrivé un moment où le transport par les cars gros porteurs coûtait jusqu’à 10.000 Fcfa l’aller, et 10.000 Fcfa le retour. Ce que tout le monde ne peut pas payer. Surtout que beaucoup de ceux qui sont en ville ont perdu leur emploi.
Quels sont les effets de ces difficultés sur les villages ?
Nos villages ne peuvent plus être fréquentés. Jusqu’à la date d’aujourd’hui, des villages sont enclavés faute de routes. Pendant 10 ans, aucune machine n’est passée pour réprofiler les voies. Les crevasses se sont accentuées. Il y a des villages pour lesquels le voyage en voiture s’arrête quelque part, et vous êtes obligés de transporter vos bagages sur la tête pour terminer le trajet. Des infrastructures tombent en ruine. Au moment où j’étais maire, le lycée de Diabo était flambant neuf et fonctionnait à plein régime. Aujourd’hui, certains bâtiments ne sont plus occupés puisqu’il n’y a même plus d’élèves. Quand on dit que les populations souffrent, c’est à tous les niveaux. C’est pourquoi nous appelons les élections et la sortie de crise de tous nos vœux.
Parlons du volet culturel et religieux des retrouvailles de la Pâques. On sait que cette fête est avant tout chrétienne. Lorsque les Baoulé se retrouvent à cette période dans leurs villages, consacrent-ils du temps à la religion chrétienne ?
La religion chrétienne évolue beaucoup dans nos régions. Je connais des personnes que je n’avais jamais imaginées un jour dans une église, et qui, aujourd’hui, vont à l’église tous les dimanches en tant que chrétiens. Cela dit, il faut reconnaître que l’engouement des Baoulé autour de la Pâques n’est pas lié à la religion chrétienne. Lorsqu’on se retrouve au village, la célébration religieuse est généralement individuelle. Celui qui est catholique se rend à l’église catholique, conformément à la pratique qu’on connaît depuis des millénaires. Pareil pour les protestants et les adeptes des autres confessions chrétiennes.
Est-ce un moment de communication des valeurs culturelles et traditionnelles entre les anciens et les jeunes venus de la ville ?
Effectivement. Nous avons quelques valeurs culturelles qui sont en voie de disparition. Par exemple, dans notre région, nous sommes en train de perdre la danse Goly. Etant donné que tous les enfants vont à l’école, il n’y a plus personne à qui il faut l’enseigner. Nous étions en train de réfléchir à la manière dont le passage de flambeau pourrait se faire de génération en génération. Le Goly, il faut le reconnaître, est d’abord un fétiche. Je ne parle pas de cet aspect cultuel, mais de l’aspect culturel et folklorique. Il y a un certain nombre de choses que nous-mêmes voulons voir disparaître. Dans certaines de nos régions, on pratique l’excision. Cette pratique comporte un aspect culturel très intéressant que nous pouvons préserver, mais elle représente un danger pour la jeune fille. Toutefois, ce sont des choses que nous abordons avec circonspection.
Nous étions en train de faire en sorte que certaines de nos valeurs culturelles ne disparaissent pas. Mais, nous avons deux adversaires. D’abord l’école qui éloigne les enfants de ces traditions. J’ai parlé du Goly. Mais, en dessous du Goly, il y a une autre petite danse pour les jeunes où on se couvre le corps de feuilles de palmier. On l’appelle Kplo. Elle imite un peu le Goly, mais elle est essentiellement culturelle. Aujourd’hui, les enfants qui vont à l’école au village ne dansent même plus le Kplo. Secundo, il y a le fait que, comme les retrouvailles ont pris de l’ampleur, et que nous étions confrontés aux problèmes de developpement, cela a pris le pas sur l’aspect culturel. Mais aujourd’hui, la préservation de la culture est à l’ordre du jour.
Faut-il s’attendre un jour à un festival sur la culture Baoulé créé autour des retrouvailles de la Pâques ?
Cela fait partie du grand projet qui a été proposé par notre frère Alain Caucautrey. C’est un projet qui va promouvoir aussi bien le développement que toutes les valeurs culturelles. Cela peut nous amener un jour à organiser un festival des arts Baoulé.
On constate une émulation autour de Paquinou. Des retrouvailles et des réunions de développement sont organisées à la même période dans d’autres régions. Comment avez-vous accueilli ce fait ?
Avec joie. Nous nous disons qu’au moins, dans la Côte d’Ivoire tout entière, nous avons posé un acte qui a fait tâche d’huile. Ce n’est pas seulement l’aspect festif qui a créé cet intérêt chez d’autres populations. En réalité, les gens se sont rendu compte que cette opération a donné quelque développement à notre région. En 1984, on a un frère inspecteur de l’enseignement primaire qui a perdu sa mère. Sa mère était de chez nous, et son père d’une autre région que je ne vais pas citer. Quand ses parents paternels et les gens de la localité où il travaillait, dans le centre-ouest, sont venus aux funérailles chez nous, devant ce qu’ils ont vu, ils étaient en train de se dire que c’est Houphouet-Boigny qui a donné de l’argent aux Baoulé pour construire leurs villages. C’était à peu près un mois avant la Pâques. Après un repas, les jeunes gens sont venus me demander l’ordre du jour de la réunion de Pâques. Je leur ai dit que ce sera le point des cotisations. Une banque nous avait prêté de l’argent pour construire des maisons, et il fallait cotiser pour rembourser. Ayant entendu cela, lorsque mes jeunes frères se sont rétirés, un des hôtes a eu le courage de me demander pourquoi il fallait payer. Pour eux, ces maisons avaient été construites par Houphouet. Je leur ai expliqué tout et ils étaient surpris. Houphouet ne pouvait pas trouver de l’argent pour construire tous les villages baoulé. L’année qui a suivi, ces visiteurs nous ont invités à une fête de retrouvailles chez eux. C’est pourquoi je dis que nous sommes contents qu’il y ait une émulation. Nous avons eu du plaisir à savoir que notre action a commencé à faire tache d’huile et que cela va permettre à la Côte d’Ivoire d’avancer un peu plus rapidement.
Que pensez-vous des retrouvailles qui se font également autour du Maoulid dans les villages du nord ?
Je crois qu’il s’agit d’une fête essentiellement religieuse. Maintenant, s’ils(les ressortissants du nord) en profitent pour s’organiser dans le sens de ce que nous faisons, c’est tant mieux. Parce que nos frères du nord investissent beaucoup ailleurs. Il serait bien que le Maoulid les amène à investir davantage dans leurs régions. Ce genre de retrouvailles ont permis une bonne avancée chez nous, même s’il reste beaucoup à faire. Nous souhaiterions que cela serve de modèle aux autres régions.
Interview réalisée par Cissé Sindou
En Côte d’Ivoire, quand la fête de Pâques arrive, tous les regards se tournent vers le peuple Baoulé qui a donné, à cette célébration chrétienne, une connotation culturelle et traditionnelle appelée Paquinou. Quelle est l’histoire de cette appellation ?
Je voudrais d’abord vous dire que le mot Paquinou ne vient pas des Baoulé. C’est une expression qui était employée par ceux qui allaient dans leurs villages pendant la période de Pâques. Quand ils parlaient entre eux, ils disaient en Baoulé : « Yé Sou Kô Di Pâques » Ce qui signifie en français : « On s’en va faire la fête de Pâques.» L’expression Paquinou en français ne me plaît pas beaucoup parce que ce n’est qu’une conjugaison qui signifie : « On s’en va à Pâques chez nous.» Pour moi, il fallait dire simplement Pâques. En effet, l’expression Paquinou signifie ‘’pendant la fête de Pâques’’ Ainsi, on pourrait dire : «Paquinou, nous avons beaucoup dansé.» Comme l’expression a été acceptée par tout le monde, on la laisse courir. Sinon, je pense qu’elle n’a pas un sens particulier. Et c’est l’imagerie populaire qui, au fur à mesure, a utilisé cette expression pour désigner la fête de Pâques. Paquinou n’est donc pas un terme créé par les Baoulé pour désigner la fête de Pâques, c’est plutôt un choix de l’extérieur qui l’a fait par abus de langage. Nous l’acceptons.
Comme vous l’avez dit, l’expression Paquinou a été employée par des Baoulé qui allaient célébrer Pâques chez eux. A quand remonte le début de ces voyages ?
A Pâques, il y a un long week-end. Mais, ce n’est pas le seul long week-end. Il y a le long week-end de Pentecôte, etc. Sauf que la fête de Pentecôte se situe en pleine période culturale. A Pâques, nous sommes encore un peu dans la saison sèche. Ce sont les vacances des paysans. Que ce soient ceux restés dans nos villages, ou ceux qui exercent dans les plantations de café-cacao en zone forestière, à l’extérieur de leur terroir. Il n’y a pas de travaux champêtres, ou très peu. Ils peuvent se donner un petit temps de vacances. Au minimum un mois qu’ils vont passer au village. En période de Pâques, les élèves et étudiants sont également en vacances pour une ou deux semaines. Les parents peuvent donc aller au village avec leurs enfants. Et comme c’est un long week-end, tous ceux qui travaillent dans les villes, fonctionnaires ou ouvriers, ont la possibilité d’aller au village. C’est la période idéale pour tous les ressortissants de chacun de nos villages de pouvoir se rendre chez eux et rendre visite aux parents. Puisque nous nous retrouvons, c’est aussi l’occasion d’échanger. C’est l’occasion quelquefois de réveiller certaines funérailles et de les achever. Voilà l’origine de cet engouement des Baoulé autour de la Pâques.
A partir de quelle année, ces mouvements ont-ils pris de l’ampleur ?
Cela remonte aux 30 dernières années. Mais, le phénomène existait bien avant. Les jeunes de nos villages allaient souvent en zone forestière pour y jouer le rôle d’ouvriers agricoles. Ils allaient pour des contrats qu’on appelait ‘’6 mois’’. Souvent, cela durait un peu plus que 6 mois, mais on l’appelait ainsi. Dès que les pluies commençaient, ils partaient travailler dans les champs des propriétaires de plantations. Vers le mois de decembre, après la récolte et la vente du café et du cacao, ils étaient payés et ils rentraient au village, pour ne revenir en zone forestière qu’à la prochaine saison des pluies, c’est-à-dire vers mai-juin. A force d’aller dans les zones forestières, beaucoup ont fini par obtenir des portions de terre pour créer leur propre plantation. C’est ainsi que beaucoup de nos parents ont pu avoir quelques hectares de plantation dans les zones forestières. Dès lors qu’ils ne sont plus de simples ouvriers agricoles et qu’ils sont devenus propriétaires de plantations, ils ne vont plus en zone forestière pour 6 mois. Leurs responsabilités s’étant accrues, ils restent dans leurs plantations. Ils ne viennent plus au village après la vente du cacao ou le payement de leurs salaires, mais au moment où ils savent que le plus grand nombre de ressortissants du village peut être là. Ce mouvement a pris de l’ampleur petit à petit et a explosé durant les 30 dernières années pour les raisons que j’ai citées plus haut.
Ce phénomène a-t-il sa racine dans une zone précise du pays baoulé, ou est-il né de façon générale ?
Il est né de façon générale parce que c’est de façon générale que ce phénomène s’est observé. Mais, si on veut parler de précurseurs, on citera surtout les Baoulé qui sont en zone de savane. C’est-à-dire la région de Bouaké, de Béoumi, etc. Quand je parle de la région de Bouaké, je parle de Diabo, Botro, Bodokro, etc. Pourquoi ? Parce que Sakassou, c’est déjà à la lisière de la forêt. Eux, ils créaient leurs plantations sur place. Yamoussoukro, c’est en pleine forêt. Eux non plus ne bougeaient pas beaucoup pour aller monnayer leurs talents d’agriculteurs ailleurs. Pareil pour M’Bahiakro, Daoukro, Dimbokro, et autres. Il n’y a que nous, ressortissants de la zone de savane, qui bougions beaucoup.
Le contenu de ces retrouvailles a-t-il été toujours celui qu’on connaît, aujourd’hui ?
Au départ, c’étaient de simples retrouvailles et c’est l’aspect festif qui était privilégié. Mais au fur et à mesure que les cadres de ces régions ont commencé à émerger, ils se sont sentis dans l’obligation de conduire leurs villages à un mieux- être. Ils devaient pour cela initier des rencontres, lancer des cotisations. L’Etat, à l’époque, avec les Fonds régionaux d’aménagements ruraux(Frar) aidait les populations à s’équiper en dispensaires, en écoles, centres culturels, etc. Pour amener les populations à montrer leur volonté d’accueillir ces infrastructures, l’Etat leur demandait une petite contribution. Et c’est à partir de ces réunions de Pâques, qu’ont été initiées les cotisations pour faire face à ces dépenses pour des équipements collectifs. Mais, petit à petit, au-delà des équipements de l’Etat, l’on a commencé à penser à la restructuration, la reconstruction et la modernisation des villages. D’où les mutuelles de développement qui ont permis de construire des villages.
Faut-il en déduire que des villages baoulé doivent leur développement aux retrouvailles de Paquinou ?
On ne peut pas dire que cela vient spécifiquement de ces retrouvailles. L’évolution du monde et du pays a été elle-même à la base de ce développement. Avant, nous étions heureux de retrouver dans nos villages des cases en banco, ou, quelquefois, des cases rondes. Ce n’est pas parce qu’il y a des retrouvailles qu’on a senti la nécessité de construire des villages avec des maisons alignées et avec les rues. C’est l’évolution elle-même qui a permis cela. Mais comment allait-on le faire ? C’est à ce niveau que les retrouvailles ont joué un rôle. Elles ont contribué à permettre la réalisation de ce développement.
Pouvez-vous citer quelques exemples de grands projets favorisés par les retrouvailles de Paquinou ?
Chez moi à N’Doumoukro, (sous-préfecture de Diabo) le village était bloqué aux confins d’une forêt clairière. La route interurbaine Bouaké-Mankono en passant par Botro passait par-là. Mais, pour passer du côté droit de la route au côté gauche, où nous avons le nouveau village avec des rues tracées, il a fallu ces retrouvailles qui ont créé des liens de solidarité entre les fils et filles du village. Cela a suscité une espèce de compétition entre les différentes strates des populations. Quand on arrivait, on disait : ceux qui viennent de la ville ont cotisé 2.000.000 ou 3.000.000 de Fcfa. Et quelquefois, les paysans qui étaient venus avec un peu moins que cela, c’est-à-dire un 1,5 million ou 2.000.000 millions, disaient : cette année, vous nous avez battus, mais, l’année prochaine, nous allons vous battre. Cela a permis de réaliser beaucoup de projets. C’est valable aussi bien pour N’Doumoukro que pour beaucoup d’autres villages.
Pouvez-vous citer d’autres exemples ?
Des villages éparpillés sur des périmètres de moins de quelques km ont décidé de se regrouper. Tout cela a été favorisé par ces retrouvailles et les concertations qu’elles permettaient. Elles ont accentué la solidarité entre tous les fils de ces villages qui se sont regroupés. Cela donne aujourd’hui de beaux villages. Je peux citer l’exemple de Andokékrénou qui est devenu une sous-préfecture dans la zone de Béoumi. Avant, l’agglomération de Diabo, elle-même, ne comptait que trois villages contigus. Mais aujourd’hui, Diabo, grâce à la solidarité et au regroupement, compte 7 à 8 villages qui forment la ville de Diabo. C’est comme la ville d’Abidjan qui est composée d’Adjamé, de l’ancien village d’Anoumabo devenu Treichville, des villages de Port-Bouët etc. A la différence qu’Abidjan étant la capitale, l’évolution n’a pas été la même qu’à Diabo. Abidjan, c’est la capitale, l’Etat y a donc fait beaucoup d’investissements.
Cette solidarité a-t-elle contribué à la promotion des cadres Baoulé ?
L’exemple que je connais le mieux, c’est celui de Diabo et du peuple Gblo auquel j’appartiens. Nous avons pensé que si nous autres avons relativement réussi à aller loin dans les études, c’est grâce au soutien des parents. Dans notre devoir de reconnaissance, nous avions le devoir de soutenir aussi nos jeunes frères. A l’époque, j’organisais, chaque année, à mon domicile (Cocody-Deux Plateaux), une rencontre avec l’ensemble des étudiants Gblo. On faisait le point pour savoir à quel niveau chacun était dans les études. Et, on se battait pour parfaire la formation de ceux qui étaient en passe de terminer. A moi-même, le président Houphouet avait dit à mon temps : « tu as une licence, mais la licence, ce n’est rien. Il faut qu’on te forme. Tu es économiste, il faut que tu intègres l’administration au niveau le plus élevé.» C’est ainsi que j’ai été envoyé en formation en France et aux Etats-Unis. Donc, à notre tour, nous soutenions nos jeunes frères et nous les aidions à évoluer. Ils sont venus plus tard s’ajouter à nous pour grossir les cotisations. Tout cela a été permis par ces retrouvailles que je considère comme le point de départ de la création de la solidarité dans nos villages, et même en ville.
Ces retrouvailles ont-elles contribué à des rapprochements entre plusieurs cantons pour des projets régionaux ?
Aujourd’hui, je peux vous répondre par non. Cela ne signifie pas que l’idée n’a pas existé et n’existe pas. Jusqu’à la date d’aujourd’hui, ce rapprochement se fait au niveau festif. Par exemple, tel canton dit : cette année, nous célébrons la Pâques de telle manière et il invite les cantons voisins qui envoient des délégations. L’idée de votre question fait son chemin. Sous la houlette d’un de nos cadres, plus jeune que nous, Alain Caucautrey, il y a un grand mouvement qui est en train de se créer au niveau du canton qu’on appelle les Allandjra. C’est un mouvement qui va soutenir le développement de l’ensemble de cette zone. C’est une zone qui part de la lisière de Bouaké jusqu’au fleuve Bandama. C’est une grande zone où on peut réaliser de nombreux projets. Des projets agro-pastoraux, de cultures industrielles à grandes échelles sont en train d’être cogités. Votre question n’est donc pas innocente.
Depuis quelques années, on constate une baisse d’engouement autour du Paquinou. Cela n’a-t-il pas freiné le développement des villages qui profitaient de ces retrouvailles ?
Effectivement, il y a une baisse d’engouement due à la crise. Or, un Baoulé qui passe la Pâques hors de sa zone ne fête pas du tout. Le jour de Pâques passe comme un jour ordinaire. Aujourd’hui, la situation s’est un peu améliorée. Mais, il y a deux ans encore, quand les gens partaient de Soubré par exemple, à destination de Diabo, ils ne dépensaient pas moins de 15.000 Fcfa ou 20.000 Fcfa sur le chemin. Pour un voyage qu’ils faisaient d’habitude en 3 ou 4 heures, il leur fallait toute une journée. Ils partaient de Soubré le matin, pour n’arriver dans leur village que la nuit, vers 21 heures. Souvent, lorsqu’ils arrivent à Bouaké la nuit, les transporteurs leur disent qu’ils ne font plus de voyage vers Diabo parce qu’il y a des ex-rebelles sur la route. Ils sont obligés de passer la nuit à Bouaké, ce qu’ils n’avaient pas prévu. Il y a aussi le fait qu’à cause de la crise, tout a augmenté. Il est arrivé un moment où le transport par les cars gros porteurs coûtait jusqu’à 10.000 Fcfa l’aller, et 10.000 Fcfa le retour. Ce que tout le monde ne peut pas payer. Surtout que beaucoup de ceux qui sont en ville ont perdu leur emploi.
Quels sont les effets de ces difficultés sur les villages ?
Nos villages ne peuvent plus être fréquentés. Jusqu’à la date d’aujourd’hui, des villages sont enclavés faute de routes. Pendant 10 ans, aucune machine n’est passée pour réprofiler les voies. Les crevasses se sont accentuées. Il y a des villages pour lesquels le voyage en voiture s’arrête quelque part, et vous êtes obligés de transporter vos bagages sur la tête pour terminer le trajet. Des infrastructures tombent en ruine. Au moment où j’étais maire, le lycée de Diabo était flambant neuf et fonctionnait à plein régime. Aujourd’hui, certains bâtiments ne sont plus occupés puisqu’il n’y a même plus d’élèves. Quand on dit que les populations souffrent, c’est à tous les niveaux. C’est pourquoi nous appelons les élections et la sortie de crise de tous nos vœux.
Parlons du volet culturel et religieux des retrouvailles de la Pâques. On sait que cette fête est avant tout chrétienne. Lorsque les Baoulé se retrouvent à cette période dans leurs villages, consacrent-ils du temps à la religion chrétienne ?
La religion chrétienne évolue beaucoup dans nos régions. Je connais des personnes que je n’avais jamais imaginées un jour dans une église, et qui, aujourd’hui, vont à l’église tous les dimanches en tant que chrétiens. Cela dit, il faut reconnaître que l’engouement des Baoulé autour de la Pâques n’est pas lié à la religion chrétienne. Lorsqu’on se retrouve au village, la célébration religieuse est généralement individuelle. Celui qui est catholique se rend à l’église catholique, conformément à la pratique qu’on connaît depuis des millénaires. Pareil pour les protestants et les adeptes des autres confessions chrétiennes.
Est-ce un moment de communication des valeurs culturelles et traditionnelles entre les anciens et les jeunes venus de la ville ?
Effectivement. Nous avons quelques valeurs culturelles qui sont en voie de disparition. Par exemple, dans notre région, nous sommes en train de perdre la danse Goly. Etant donné que tous les enfants vont à l’école, il n’y a plus personne à qui il faut l’enseigner. Nous étions en train de réfléchir à la manière dont le passage de flambeau pourrait se faire de génération en génération. Le Goly, il faut le reconnaître, est d’abord un fétiche. Je ne parle pas de cet aspect cultuel, mais de l’aspect culturel et folklorique. Il y a un certain nombre de choses que nous-mêmes voulons voir disparaître. Dans certaines de nos régions, on pratique l’excision. Cette pratique comporte un aspect culturel très intéressant que nous pouvons préserver, mais elle représente un danger pour la jeune fille. Toutefois, ce sont des choses que nous abordons avec circonspection.
Nous étions en train de faire en sorte que certaines de nos valeurs culturelles ne disparaissent pas. Mais, nous avons deux adversaires. D’abord l’école qui éloigne les enfants de ces traditions. J’ai parlé du Goly. Mais, en dessous du Goly, il y a une autre petite danse pour les jeunes où on se couvre le corps de feuilles de palmier. On l’appelle Kplo. Elle imite un peu le Goly, mais elle est essentiellement culturelle. Aujourd’hui, les enfants qui vont à l’école au village ne dansent même plus le Kplo. Secundo, il y a le fait que, comme les retrouvailles ont pris de l’ampleur, et que nous étions confrontés aux problèmes de developpement, cela a pris le pas sur l’aspect culturel. Mais aujourd’hui, la préservation de la culture est à l’ordre du jour.
Faut-il s’attendre un jour à un festival sur la culture Baoulé créé autour des retrouvailles de la Pâques ?
Cela fait partie du grand projet qui a été proposé par notre frère Alain Caucautrey. C’est un projet qui va promouvoir aussi bien le développement que toutes les valeurs culturelles. Cela peut nous amener un jour à organiser un festival des arts Baoulé.
On constate une émulation autour de Paquinou. Des retrouvailles et des réunions de développement sont organisées à la même période dans d’autres régions. Comment avez-vous accueilli ce fait ?
Avec joie. Nous nous disons qu’au moins, dans la Côte d’Ivoire tout entière, nous avons posé un acte qui a fait tâche d’huile. Ce n’est pas seulement l’aspect festif qui a créé cet intérêt chez d’autres populations. En réalité, les gens se sont rendu compte que cette opération a donné quelque développement à notre région. En 1984, on a un frère inspecteur de l’enseignement primaire qui a perdu sa mère. Sa mère était de chez nous, et son père d’une autre région que je ne vais pas citer. Quand ses parents paternels et les gens de la localité où il travaillait, dans le centre-ouest, sont venus aux funérailles chez nous, devant ce qu’ils ont vu, ils étaient en train de se dire que c’est Houphouet-Boigny qui a donné de l’argent aux Baoulé pour construire leurs villages. C’était à peu près un mois avant la Pâques. Après un repas, les jeunes gens sont venus me demander l’ordre du jour de la réunion de Pâques. Je leur ai dit que ce sera le point des cotisations. Une banque nous avait prêté de l’argent pour construire des maisons, et il fallait cotiser pour rembourser. Ayant entendu cela, lorsque mes jeunes frères se sont rétirés, un des hôtes a eu le courage de me demander pourquoi il fallait payer. Pour eux, ces maisons avaient été construites par Houphouet. Je leur ai expliqué tout et ils étaient surpris. Houphouet ne pouvait pas trouver de l’argent pour construire tous les villages baoulé. L’année qui a suivi, ces visiteurs nous ont invités à une fête de retrouvailles chez eux. C’est pourquoi je dis que nous sommes contents qu’il y ait une émulation. Nous avons eu du plaisir à savoir que notre action a commencé à faire tache d’huile et que cela va permettre à la Côte d’Ivoire d’avancer un peu plus rapidement.
Que pensez-vous des retrouvailles qui se font également autour du Maoulid dans les villages du nord ?
Je crois qu’il s’agit d’une fête essentiellement religieuse. Maintenant, s’ils(les ressortissants du nord) en profitent pour s’organiser dans le sens de ce que nous faisons, c’est tant mieux. Parce que nos frères du nord investissent beaucoup ailleurs. Il serait bien que le Maoulid les amène à investir davantage dans leurs régions. Ce genre de retrouvailles ont permis une bonne avancée chez nous, même s’il reste beaucoup à faire. Nous souhaiterions que cela serve de modèle aux autres régions.
Interview réalisée par Cissé Sindou