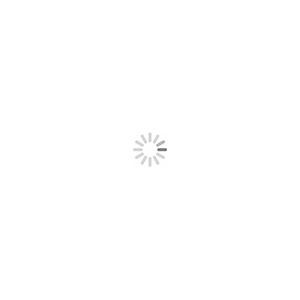A la suite de travaux sur la «guerre nomade» ouest-africaine, on s’interroge ici sur la sociologie politique d’un mouvement rebelle, entre ethnicité et internationalisation. Quels écarts entre les pratiques de violence discontinue envers les civils et les discours anti-discriminations, entre épuration ethnique larvée et positions révolutionnaires ? L’étude des strates successives du mouvement rebelle, des clans et groupes qui le composent aboutit à un «diagramme de pouvoirs» qui va des communautés locales aux alliances avec les pays voisins et aux soutiens occidentaux. Mais un approfondissement de la genèse du mouvement montre en fait certains caractères «post-modernes» de telles rebellions, où la sympathie plus ou moins manipulée de médias étrangers aboutit, via un sigle au début largement artificiel (Mpci), à une véritable co-création d’un mouvement politico-militaire, dont militaires, politiques et humanitaires occidentaux se sont emparés sans recul critique – notamment en refusant de connaître l’«idéologie mandingue», symétrique de «l’ivoirité» et justifiant par avance une violence conquérante. C’est aussi l’occasion, en termes foucaldiens, de jauger la «gouvernance par la violence» de la zone rebelle, mais aussi sa gouvernementalité : en termes d’informalisation des trafics en tous genres, de résistance des communautés villageoises, de persistance des factions militaires sous-tendues par les clivages de l’ethnicité; enfin d’analyser les dilemmes politiques du mouvement rebelle, entre création d’un proto-Etat peu viable (ou son rattachement au Burkina), et ralliement - moyennant compensations -au processus de réintégration nationale, de désarmement et de participation au processus électoral.
Amnesty international, qu’on ne peut suspecter d’excessive sympathie envers le camp gouvernemental, décrit ainsi le massacre des gendarmes de Bouaké et de leurs familles, selon des témoignages recoupés : «A Bouaké, le 6 octobre 2002, une soixantaine de gendarmes accompagnés d’une cinquantaine de leurs enfants et de quelques autres civils ont été arrêtés dans leur caserne par des éléments armés du Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire (Mpci) qui avaient pris le contrôle de la deuxième ville du pays depuis le 19 septembre 2002. Ces personnes ont été conduites à la prison du camp militaire du 3e bataillon d’infanterie. Ce même soir, des éléments armés du Mpci sont entrés à plusieurs reprises dans la prison et ont tiré en rafales, tuant et blessant des dizaines de détenus. Les survivants sont restés deux jours avec les blessés et les cadavres en décomposition sans recevoir de nourriture. Certains ont été contraints de transporter les cadavres et de les enterrer dans des fosses collectives et une dizaine d’entre eux ont très vraisemblablement été tués sur les lieux mêmes du charnier après qu’ils eurent enterré leurs camarades». Pas d’images de ces violences extrêmes, un peu à l’instar de Kigali : bien que les situations soient très différentes, la médiatisation saisit parfois, a posteriori, l’inverse du réel…
Expression qui fait florès même hors de l’Hexagone
En revanche, l’opinion publique internationale se souvient de l’épisode télévisuel montrant, aux accords de Linas-Marcoussis, le «leader des Forces nouvelles», Guillaume Soro, ex-activiste étudiant pressenti par le gouvernement français, en 2002, comme… «ministre de la Défense» à Abidjan ! Quelle scène alors retenir pour symboliser une rébellion pour laquelle les médias occidentaux ont longtemps eu les yeux de Chimène, ces «rebelles qui sourient», défenseurs des opprimés ?
L’analyse d’une telle rébellion semble d’autant plus une mission impossible que les observateurs sont le plus souvent des acteurs impliqués, ne serait-ce qu’à cause des liens étroits qu’entretiennent historiquement les pays concernés – au-delà des affinités en réseaux politiques ou intellectuels, où se sont constituées des élites transnationales franco-africaines. Pourtant, après le reflux d’un temps des illusions médiatiques sur les «sympathiques» rebelles nordistes, les campagnes de mise sous tutelle du camp gouvernemental par les Institutions internationales et les massacres de novembre 2004 constituent bien des éléments majeurs dans le champ politologique africaniste et dans celui des relations internationales. Quelles sont donc les différentes phases de la connaissance de la rébellion ivoirienne et de ses perceptions médiatiques et politiques, aussi bien à Abidjan qu’à l’étranger ? Chacun comprend bien d’ailleurs que les réponses ne peuvent qu’être provisoires : les commanditaires, les financements, les alliances de la rébellion ne sont en effet connus que partiellement.
Construction des
rébellions : des périphéries insurgées ?
Si les rebellions locales ont tout intérêt, pour asseoir leur légitimité, à se poser dans un contexte national et à nier les influences ou alliances extérieures, un comparatisme rapide découvre au contraire bon nombre de liens étonnants, au-delà des discours. Si des chercheurs comme Stephen Ellis et surtout Paul Ritchards ont mis l’accent sur les catégories d’âge et l’ethnicité de rébellions socialement et politiquement dominées, nous avons mis en évidence le caractère spatialement périphérique (dans une double acception : spatiale et sociale) de ces mouvements ; remarque d’ailleurs assez désespérante à terme, car à cause de la conquête de l’époque coloniale, procédant des côtes vers l’intérieur, ce caractère politique des périphéries dominées et délaissées semble évidemment structurel. (…)
«Rassemblement des Républicains» de l’opposant Alassane Ouattara.
Le discours structurant des rébellions peut avoir une certaine consistance idéologique – bien que leurs pratiques en diffèrent sensiblement : discours anti-corruption et anti-crio du Ruf de Sierra Leone, revendications libératrices du Nplf de Taylor contre la dictature Doe, revendications pro-Rdr ou illustrant des revendications nordistes contre l’ivoirité de la part du Mpci en Côte d’Ivoire. Autant de registres évocateurs de revendications politiques, même s’ils heurtent l’épure marxiste des guérillas anciennes. A travers ces idéologies mobilisatrices se dessinent d’ailleurs mieux les failles et les faillites des Etats concernés que les solutions à venir : fonction tribunitienne des guérillas devant la corruption du système électif, qui se heurtent aux structures sociales (que faire contre la démographie galopante et la subordination structurelle de la jeunesse ?). Elles ne proposent au mieux qu’une alternance de prédation : «à chacun son tour… de manger !», selon une métaphore bien connue, depuis les travaux désormais classiques de Jean-François Bayart, et qui exprime bien une certaine logique autochtone du politique.
Le Rdr a-t-il créé un monstre ?
Telle est en effet «la thèse moyenne» du coup d’Etat, intermédiaire entre «la théorie du complot» ex-nihilo (dont le maître, bien sûr, est encore caché) qui, universellement, satisfait à peu de frais les esprits simples, et celle du «reflet», qui verrait bien à tort les mouvements insurrectionnels comme le seul bras armé du Rdr et de ses alliés. S’il faut la caricaturer à son tour en la dénommant, l’interprétation par «l’apprenti sorcier» comporte en effet, l’avantage provisoire de rendre compte de l’autonomisation partielle de la rébellion et de son ancrage territorial, l’un expliquant partiellement l’autre sans toutefois en épuiser le sens. Il faut donc partir méthodologiquement de «ce mystère des origines» qui n’est pas sans rappeler celui des sociétés secrètes, et dont le charme agit encore pour attirer de nouveaux combattants, aventuriers des temps modernes de toute la région, qui ont trouvé dans le nomadisme guerrier une situation durable… avant leur fin possible.
Groupe salafiste pour la prédication et le combat.
Les interprétations extrêmes et symétriques abondent : pour le camp présidentiel, il s’agit à la fois de putschistes militaires assoiffés de pur pouvoir, de «terroristes islamistes» – de type Gspc–, de cinquième colonne burkinabé, ou d’un simple «montage» des services occidentaux en général, français en particulier… Parfaitement contradictoires, ces interprétations ont le mérite d’une fausse clarté et, pourtant, s’appuient tour à tour sur d’indéniables indices tirés de la chronologie du mouvement.
Environ 750 jeunes militaires promis à la démobilisation en décembre 2002. Par certains côtés, le Mpci est bien une rébellion post-moderne, sauf à ignorer que bien des mouvements politico-militaires jouent des effets d’images et de signifiants. On discerne facilement des composantes assez mal hiérarchisées et en constante réorganisation. Au tout début, deux groupes de jeunes recrues ivoiriennes «déflatées», de leur nom de classe : «Zinzins et Blofoués» avec des rescapés en exil au Burkina de putsch et d’épurations ivoiriennes successifs, et parmi eux, des proches – civils ou militaires – du leader du Rdr.
Au-delà, foisonnent des données plus hypothétiques : si le lien avec des mouvements estudiantins et «l’école de la Fesci» est évident avec Guillaume Soro, si des militaires de l’armée officielle se sont ralliés (à mesure, pour certains, qu’ils étaient limogés à Abidjan), la présence au début de la rébellion de «mercenaires» libériens et/ou sierra léonais semble attestée et fait partie de ce «nomadisme» des guerriers ouest-africains.
Question clef opposant les autorités ivoiriennes qui demandaient en septembre 2002 les applications des accords de défense
A ce propos, «les guerriers urbains» d’Abidjan magnifiés par la cinéaste Eliane de la Tour, sont-ils représentatifs des milieux délinquants urbains qui auraient pu passer à la rébellion nordiste ? Si les cas avérés semblent minoritaires, il est en revanche certain que marginaux et jeunes exclus (qui forment en partie des unités d’«enfants soldats», surtout vers l’Ouest libérien), petits métiers, chômeurs des villes et des campagnes du Nord ont rapidement formé des troupes supplétives aux soldats d’une rébellion, au début inférieure à un millier d’hommes – et qui a trouvé à travers eux un certain enracinement ethnique. Plus hypothétique encore, la présence de contingents burkinabè, avec ou sans uniforme, même s’il est de notoriété publique que Ouagadougou sert de base arrière aux leaders rebelles qui y possédaient, grâce au Président Compaoré, villas et 4x4, subsides et armes, ainsi que des facilités de voyage à l’étranger et d’entraînement militaire. Mouvement populaire ivoirien du grand Ouest. Mouvement pour la justice et la paix. «Mouvements fantômes», que des analystes férus de «renseignement militaire» essayaient en vain (...) De ces contingents hétérogènes, sigles et médias ont trop vite fait une unité, à la fois guérilla et mouvement politique. L’«opération Mpci» a bien été, de l’avis de beaucoup, montée a posteriori, après l’échec du putsch et son cantonnement par la force Licorne au Nord de la Côte d’Ivoire. «Force du signifiant» : à l’époque, ni le sigle ni a fortiori la fonction de son «Secrétaire général» n’avaient d’existence, ni de consistance : s’il ne s’agit pas de pure «vitrine» sémantique, ni d’intoxication de la presse internationale, l’opération a introduit des réalignements inédits, mais a favorisé un clivage inattendu militaires/civils, ces derniers dirigeant par le Verbe, source de constantes tensions. Des opérations secondaires, comme la duplication d’un Mpigo ou du Mjp à l’Ouest de la Côte d’Ivoire , ont tenu le temps de délégations surréalistes à Marcoussis et ont été réduites par la force, de manière sanglante… par la direction rebelle elle-même !
Rapports de pouvoir et de situations factionnelles, d’alliances politiques ou ethniques
Le pouvoir rebelle, en dehors du clivage factionnel Ib/Soro, est plus à concevoir comme une nébuleuse, faite d’agencements changeants de chefs de guerre et de leurs troupes, que comme un système de commandement hiérarchisé. Ici aussi, la labellisation des leaders locaux peut faire illusion, tels les «Com-zones» («commandant de zones», zones qui sont elles-mêmes divisées en «commandements opérationnels», puis en «postes» – organisation largement fictive…) ; mais la pratique semble celle de rivalités incessantes pour les rackets, régulées par les armes. Ainsi, une logique de fiefs se développe, comme une territorialisation de la violence, obligée par là même de passer des alliances avec les pouvoirs autochtones, comme Koné Zackaria, le chef de guerre de Vavoua. Un certain repli sur les fiefs se fait jour, depuis l’exécution du caporal-chef Bamba Kassoum, taxé de pro-I.B. et bien avant, celle du chef de guerre Adams, à Korhogo.
Ferme M., La figure du chasseur et les chasseurs-miliciens dans le conflit sierra-léonais»
Cependant, le corps des «dozo», proche des kamajors sierra léonais, reste une force intermédiaire entre les anciens militaires ivoiriens, gardes du corps ou mercenaires, et la piétaille des milices villageoises ou urbaines, leurs troupes de base. A mi-chemin entre une tradition poro réinterprétée et une armée rebelle, les dozo ne sont aucunement l’apparition au grand jour des «chasseurs traditionnels villageois», comme le montre bien Marianne Ferme, dans le cas sierra léonais. Toutefois, leur attirail et leurs pratiques magico-religieuses, qui s’inspirent de l’univers poro, ne sont pas sans influence, militairement efficaces car socialement partagés. Sur le savoureux site Internet de la «Compagnie guépard», autrement dit les dozo intégrés dans la rébellion à Bouaké, un journaliste sympathisant (et complaisant : ne sont-ils pas les «guerriers de la Lumière» ?) détaille leurs pouvoirs : transformation en animaux, invisibilité, invulnérabilité aux balles, et prescience pour les «chefs dozo», comme Bamba, Ibrahim Konaté, Chérif Ousmane ! On comprend que les combattants sudistes soient surclassés… Comme au Liberia, l’aspect emprunte à la fois à la «panoplie ethnique» du mysticisme des chasseurs : dreadlocks, kaolin, attirail de miroirs, colliers de cauris, amulettes et tuniques sont effectivement censés terrifier l’adversaire. Bien que, globalement, un appareil de conquête se substitue à l’appareil d’Etat détruit et se surimpose aux communautés autochtones (en particulier en pays Baoulé, où la rébellion est bien plus «étrangère» qu’au Nord Sénoufo ou Malinké), d’autres dispositifs s’observent sporadiquement. Au Nord, rien ne peut fonctionner au quotidien sans les pouvoirs autochtones, comme ceux des «tarfolo» Sénoufo pour la terre, ou des «grandes familles» comme les Gbon Coulibaly à Korhogo. A plusieurs reprises, une articulation avec le «pouvoir coutumier» a évité à la rébellion d’être décimée : en particulier lors de «l’épuration ethnique» de Bouaké (exclusion des populations Baoulé au profit des Dioula) et lors des tentatives, en octobre 2004, pour reprendre la ville, lorsque des vendetta et des règlements de compte entre groupes ethniques prenaient de l’ampleur. Des négociations et des médiations ont empêché in extremis la situation de passer hors de contrôle de la rébellion, de même, lors de massacres réciproques entre partisans de Ib et de Soro en décembre 2003. Pratiques de la violence La violence militaire, criminelle ou politique, en zone rebelle, est mal connue et mal documentée, à tel point que certains observateurs, paraphrasant la formule connue en Occident, prétendent que «les observateurs des Droits de l’Homme sont au Sud, les crimes de guerre au Nord». En termes de gouvernance et de définition de la légitimité de la rébellion, de la cohérence de ses pratiques avec son idéologie, le sujet est pourtant crucial. Le thème de la violence peut cependant se nuancer selon les temps et les lieux : dans sa dimension chronologique, les débuts sont marqués non seulement par la «violence de guerre» contre l’armée ivoirienne, et les autres «corps habillés», mais aussi par des massacres de fonctionnaires et de civils sudistes qui restent à préciser; puis, par une «épuration ethnique» largement sous-évaluée, notamment de la part de la galaxie humanitaire qui collabore avec la rébellion en zone Nord, en particulier dans la ville de Bouaké ; enfin, par un massacre ethnico-factionnel au sein de la rébellion, lors de l’épuration violente par les miliciens de Guillaume Soto – surtout Sénoufo, des partisans d’Ibrahim Coulibaly – en grande partie Malinké :
Monique Mas, sur Rfi, le 3 août 2004.
«L’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire” (Onuci) a découvert trois charniers au Nord de la Côte d’Ivoire, dans la région de Korhogo où se sont rendus par deux fois ses enquêteurs chargés des Droits de l’Homme et de la police, du 1er au 12 juillet et du 22 au 26 juillet derniers. Avant même la publication de leur rapport, les spécialistes onusiens ont annoncé le 2 août qu’ils avaient pu établir la mise à mort, par balles, décapitation ou asphyxie, de quelque 99 personnes au moins. Les corps ensevelis dans trois sites seraient identifiés comme ceux de victimes des affrontements qui ont opposé dans la métropole nordiste des factions rivales de l’ancienne rébellion du Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire (Mpci), les 20 et 21 juin dernier. La victoire était alors revenue à Guillaume Soro, l’actuel chef politique des Forces nouvelles».
Y compris, à l’inverse pour un «maintien de l’ordre» très militaire : en 2003 par exemple…
Cela n’empêche pas une «violence ordinaire» contre la population autochtone, régulière et sanglante, encore plus mal connue, due en particulier à l’absence de forces de l’ordre de l’appareil militaire rebelle et qui devrait conduire à reposer, comme au Congo, en Ouganda, au Liberia, au Sierra Leone, etc, la question de la criminalisation de ce pouvoir et des sanctions juridiques encourues.
A ce propos, une sorte de scène prototypique pour l’opinion ivoirienne pourrait être celle du massacre gratuit, par un groupe de rebelles, de jeunes filles Baoulé exécutant dans un petit village près de Sakassou une danse rituelle d’exorcisme de la violence. Cet épisode mineur, qui a autant touché les imaginations que l’immolation des enfants de gendarmes sudistes de Bouaké, a bien sûr à voir avec la perte d’une certaine innocence du vivre ensemble, du temps des rituels remplacé par celui de la violence pure. Enfin, ce que l’on a pu appeler la «libérianisation» de l’Ouest conduit à des formes de violence plus anomiques, en tout cas proches de celles observées lors du conflit du Liberia, à tel point que la rébellion elle-même s’est débarrassée de leaders comme le «pseudo Doe» et de groupes nomades enfreignant les pratiques de la rébellion de Bouaké, elle-même pourtant peu regardante sur les exactions contre les civils.
D’origine Baoulé, N’Dri N’Guessan alias sergent Félix Doe, a été tué en avril 2003
Ainsi on a pu parler d’«épuration ethnique sporadique» sur plusieurs points de la zone rebelle, en particulier dans les territoires proches du Liberia, contre les Guéré en particulier. Il est vrai que cette «libérianisation» du territoire ivoirien reste partagée, puisque les deux camps – loyaliste et rebelle – ont instrumentalisé à la fois des couples d’oppositions ethniques transfrontalières, depuis longtemps sous-jacents (Gyo/Dan vs Wê/Krahns) et des groupes nomades mercenaires, issus des conflits du Liberia et de la Sierra Leone, et en quelque sorte recomposés pour poursuivre leurs carrières guerrières. L’évolution sanglante de l’Ouest a tellement porté tort à l’ensemble de la rébellion, que le «pseudo Doe», leader éphémère de l’inconsistant Mpigo, a vraisemblablement été exécuté par les partisans de Guillaume Soro.
Dans la «capitale rebelle», Bouaké, il semble que les pratiques des groupes militaro-mafieux, de type «Camorra», «Cosa nostra» et autres «Ninja», qu’a connu Abidjan sous la dictature militaire du Général Gueï, restent les mêmes. Cela n’étonne aucun analyste, tant il est connu qu’un groupe des «fondateurs» de la rébellion est justement issu de cette mouvance. Selon une enquête de la Ligue des Droits de l’Homme ivoirienne (Lidho) de février 2003, «environ 80 % des violences sont perpétrées par les rebelles» : il faut bien dire que l’image qu’en donnent les médias français et une certaine recherche politologique ne l’a guère évoqué… Comme nous l’avons signalé, les enquêtes villageoises en particulier restent à faire dans la zone Nord. Depuis plusieurs années, les Ong françaises de terrain, telles Acf, remarquent que la violence systématique contre les populations civiles de l’Ouest sont très sous-estimées. Il faut y voir la conjugaison d’incursions libériennes et de pratiques extrêmes, qui échappent en partie au (contre-) pouvoir de Bouaké, avec une criminalisation des forces en présence, aggravée par un système de représailles non seulement interethniques (inter-ivoirien), mais avec les immigrants nordistes au sens large («Dioula» sahéliens) dans une compétition foncière aiguë.
Michel Galy politologue,
chercheur au Centre sur les conflits et animateurs de la revue «Culture et conflits».
Amnesty international, qu’on ne peut suspecter d’excessive sympathie envers le camp gouvernemental, décrit ainsi le massacre des gendarmes de Bouaké et de leurs familles, selon des témoignages recoupés : «A Bouaké, le 6 octobre 2002, une soixantaine de gendarmes accompagnés d’une cinquantaine de leurs enfants et de quelques autres civils ont été arrêtés dans leur caserne par des éléments armés du Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire (Mpci) qui avaient pris le contrôle de la deuxième ville du pays depuis le 19 septembre 2002. Ces personnes ont été conduites à la prison du camp militaire du 3e bataillon d’infanterie. Ce même soir, des éléments armés du Mpci sont entrés à plusieurs reprises dans la prison et ont tiré en rafales, tuant et blessant des dizaines de détenus. Les survivants sont restés deux jours avec les blessés et les cadavres en décomposition sans recevoir de nourriture. Certains ont été contraints de transporter les cadavres et de les enterrer dans des fosses collectives et une dizaine d’entre eux ont très vraisemblablement été tués sur les lieux mêmes du charnier après qu’ils eurent enterré leurs camarades». Pas d’images de ces violences extrêmes, un peu à l’instar de Kigali : bien que les situations soient très différentes, la médiatisation saisit parfois, a posteriori, l’inverse du réel…
Expression qui fait florès même hors de l’Hexagone
En revanche, l’opinion publique internationale se souvient de l’épisode télévisuel montrant, aux accords de Linas-Marcoussis, le «leader des Forces nouvelles», Guillaume Soro, ex-activiste étudiant pressenti par le gouvernement français, en 2002, comme… «ministre de la Défense» à Abidjan ! Quelle scène alors retenir pour symboliser une rébellion pour laquelle les médias occidentaux ont longtemps eu les yeux de Chimène, ces «rebelles qui sourient», défenseurs des opprimés ?
L’analyse d’une telle rébellion semble d’autant plus une mission impossible que les observateurs sont le plus souvent des acteurs impliqués, ne serait-ce qu’à cause des liens étroits qu’entretiennent historiquement les pays concernés – au-delà des affinités en réseaux politiques ou intellectuels, où se sont constituées des élites transnationales franco-africaines. Pourtant, après le reflux d’un temps des illusions médiatiques sur les «sympathiques» rebelles nordistes, les campagnes de mise sous tutelle du camp gouvernemental par les Institutions internationales et les massacres de novembre 2004 constituent bien des éléments majeurs dans le champ politologique africaniste et dans celui des relations internationales. Quelles sont donc les différentes phases de la connaissance de la rébellion ivoirienne et de ses perceptions médiatiques et politiques, aussi bien à Abidjan qu’à l’étranger ? Chacun comprend bien d’ailleurs que les réponses ne peuvent qu’être provisoires : les commanditaires, les financements, les alliances de la rébellion ne sont en effet connus que partiellement.
Construction des
rébellions : des périphéries insurgées ?
Si les rebellions locales ont tout intérêt, pour asseoir leur légitimité, à se poser dans un contexte national et à nier les influences ou alliances extérieures, un comparatisme rapide découvre au contraire bon nombre de liens étonnants, au-delà des discours. Si des chercheurs comme Stephen Ellis et surtout Paul Ritchards ont mis l’accent sur les catégories d’âge et l’ethnicité de rébellions socialement et politiquement dominées, nous avons mis en évidence le caractère spatialement périphérique (dans une double acception : spatiale et sociale) de ces mouvements ; remarque d’ailleurs assez désespérante à terme, car à cause de la conquête de l’époque coloniale, procédant des côtes vers l’intérieur, ce caractère politique des périphéries dominées et délaissées semble évidemment structurel. (…)
«Rassemblement des Républicains» de l’opposant Alassane Ouattara.
Le discours structurant des rébellions peut avoir une certaine consistance idéologique – bien que leurs pratiques en diffèrent sensiblement : discours anti-corruption et anti-crio du Ruf de Sierra Leone, revendications libératrices du Nplf de Taylor contre la dictature Doe, revendications pro-Rdr ou illustrant des revendications nordistes contre l’ivoirité de la part du Mpci en Côte d’Ivoire. Autant de registres évocateurs de revendications politiques, même s’ils heurtent l’épure marxiste des guérillas anciennes. A travers ces idéologies mobilisatrices se dessinent d’ailleurs mieux les failles et les faillites des Etats concernés que les solutions à venir : fonction tribunitienne des guérillas devant la corruption du système électif, qui se heurtent aux structures sociales (que faire contre la démographie galopante et la subordination structurelle de la jeunesse ?). Elles ne proposent au mieux qu’une alternance de prédation : «à chacun son tour… de manger !», selon une métaphore bien connue, depuis les travaux désormais classiques de Jean-François Bayart, et qui exprime bien une certaine logique autochtone du politique.
Le Rdr a-t-il créé un monstre ?
Telle est en effet «la thèse moyenne» du coup d’Etat, intermédiaire entre «la théorie du complot» ex-nihilo (dont le maître, bien sûr, est encore caché) qui, universellement, satisfait à peu de frais les esprits simples, et celle du «reflet», qui verrait bien à tort les mouvements insurrectionnels comme le seul bras armé du Rdr et de ses alliés. S’il faut la caricaturer à son tour en la dénommant, l’interprétation par «l’apprenti sorcier» comporte en effet, l’avantage provisoire de rendre compte de l’autonomisation partielle de la rébellion et de son ancrage territorial, l’un expliquant partiellement l’autre sans toutefois en épuiser le sens. Il faut donc partir méthodologiquement de «ce mystère des origines» qui n’est pas sans rappeler celui des sociétés secrètes, et dont le charme agit encore pour attirer de nouveaux combattants, aventuriers des temps modernes de toute la région, qui ont trouvé dans le nomadisme guerrier une situation durable… avant leur fin possible.
Groupe salafiste pour la prédication et le combat.
Les interprétations extrêmes et symétriques abondent : pour le camp présidentiel, il s’agit à la fois de putschistes militaires assoiffés de pur pouvoir, de «terroristes islamistes» – de type Gspc–, de cinquième colonne burkinabé, ou d’un simple «montage» des services occidentaux en général, français en particulier… Parfaitement contradictoires, ces interprétations ont le mérite d’une fausse clarté et, pourtant, s’appuient tour à tour sur d’indéniables indices tirés de la chronologie du mouvement.
Environ 750 jeunes militaires promis à la démobilisation en décembre 2002. Par certains côtés, le Mpci est bien une rébellion post-moderne, sauf à ignorer que bien des mouvements politico-militaires jouent des effets d’images et de signifiants. On discerne facilement des composantes assez mal hiérarchisées et en constante réorganisation. Au tout début, deux groupes de jeunes recrues ivoiriennes «déflatées», de leur nom de classe : «Zinzins et Blofoués» avec des rescapés en exil au Burkina de putsch et d’épurations ivoiriennes successifs, et parmi eux, des proches – civils ou militaires – du leader du Rdr.
Au-delà, foisonnent des données plus hypothétiques : si le lien avec des mouvements estudiantins et «l’école de la Fesci» est évident avec Guillaume Soro, si des militaires de l’armée officielle se sont ralliés (à mesure, pour certains, qu’ils étaient limogés à Abidjan), la présence au début de la rébellion de «mercenaires» libériens et/ou sierra léonais semble attestée et fait partie de ce «nomadisme» des guerriers ouest-africains.
Question clef opposant les autorités ivoiriennes qui demandaient en septembre 2002 les applications des accords de défense
A ce propos, «les guerriers urbains» d’Abidjan magnifiés par la cinéaste Eliane de la Tour, sont-ils représentatifs des milieux délinquants urbains qui auraient pu passer à la rébellion nordiste ? Si les cas avérés semblent minoritaires, il est en revanche certain que marginaux et jeunes exclus (qui forment en partie des unités d’«enfants soldats», surtout vers l’Ouest libérien), petits métiers, chômeurs des villes et des campagnes du Nord ont rapidement formé des troupes supplétives aux soldats d’une rébellion, au début inférieure à un millier d’hommes – et qui a trouvé à travers eux un certain enracinement ethnique. Plus hypothétique encore, la présence de contingents burkinabè, avec ou sans uniforme, même s’il est de notoriété publique que Ouagadougou sert de base arrière aux leaders rebelles qui y possédaient, grâce au Président Compaoré, villas et 4x4, subsides et armes, ainsi que des facilités de voyage à l’étranger et d’entraînement militaire. Mouvement populaire ivoirien du grand Ouest. Mouvement pour la justice et la paix. «Mouvements fantômes», que des analystes férus de «renseignement militaire» essayaient en vain (...) De ces contingents hétérogènes, sigles et médias ont trop vite fait une unité, à la fois guérilla et mouvement politique. L’«opération Mpci» a bien été, de l’avis de beaucoup, montée a posteriori, après l’échec du putsch et son cantonnement par la force Licorne au Nord de la Côte d’Ivoire. «Force du signifiant» : à l’époque, ni le sigle ni a fortiori la fonction de son «Secrétaire général» n’avaient d’existence, ni de consistance : s’il ne s’agit pas de pure «vitrine» sémantique, ni d’intoxication de la presse internationale, l’opération a introduit des réalignements inédits, mais a favorisé un clivage inattendu militaires/civils, ces derniers dirigeant par le Verbe, source de constantes tensions. Des opérations secondaires, comme la duplication d’un Mpigo ou du Mjp à l’Ouest de la Côte d’Ivoire , ont tenu le temps de délégations surréalistes à Marcoussis et ont été réduites par la force, de manière sanglante… par la direction rebelle elle-même !
Rapports de pouvoir et de situations factionnelles, d’alliances politiques ou ethniques
Le pouvoir rebelle, en dehors du clivage factionnel Ib/Soro, est plus à concevoir comme une nébuleuse, faite d’agencements changeants de chefs de guerre et de leurs troupes, que comme un système de commandement hiérarchisé. Ici aussi, la labellisation des leaders locaux peut faire illusion, tels les «Com-zones» («commandant de zones», zones qui sont elles-mêmes divisées en «commandements opérationnels», puis en «postes» – organisation largement fictive…) ; mais la pratique semble celle de rivalités incessantes pour les rackets, régulées par les armes. Ainsi, une logique de fiefs se développe, comme une territorialisation de la violence, obligée par là même de passer des alliances avec les pouvoirs autochtones, comme Koné Zackaria, le chef de guerre de Vavoua. Un certain repli sur les fiefs se fait jour, depuis l’exécution du caporal-chef Bamba Kassoum, taxé de pro-I.B. et bien avant, celle du chef de guerre Adams, à Korhogo.
Ferme M., La figure du chasseur et les chasseurs-miliciens dans le conflit sierra-léonais»
Cependant, le corps des «dozo», proche des kamajors sierra léonais, reste une force intermédiaire entre les anciens militaires ivoiriens, gardes du corps ou mercenaires, et la piétaille des milices villageoises ou urbaines, leurs troupes de base. A mi-chemin entre une tradition poro réinterprétée et une armée rebelle, les dozo ne sont aucunement l’apparition au grand jour des «chasseurs traditionnels villageois», comme le montre bien Marianne Ferme, dans le cas sierra léonais. Toutefois, leur attirail et leurs pratiques magico-religieuses, qui s’inspirent de l’univers poro, ne sont pas sans influence, militairement efficaces car socialement partagés. Sur le savoureux site Internet de la «Compagnie guépard», autrement dit les dozo intégrés dans la rébellion à Bouaké, un journaliste sympathisant (et complaisant : ne sont-ils pas les «guerriers de la Lumière» ?) détaille leurs pouvoirs : transformation en animaux, invisibilité, invulnérabilité aux balles, et prescience pour les «chefs dozo», comme Bamba, Ibrahim Konaté, Chérif Ousmane ! On comprend que les combattants sudistes soient surclassés… Comme au Liberia, l’aspect emprunte à la fois à la «panoplie ethnique» du mysticisme des chasseurs : dreadlocks, kaolin, attirail de miroirs, colliers de cauris, amulettes et tuniques sont effectivement censés terrifier l’adversaire. Bien que, globalement, un appareil de conquête se substitue à l’appareil d’Etat détruit et se surimpose aux communautés autochtones (en particulier en pays Baoulé, où la rébellion est bien plus «étrangère» qu’au Nord Sénoufo ou Malinké), d’autres dispositifs s’observent sporadiquement. Au Nord, rien ne peut fonctionner au quotidien sans les pouvoirs autochtones, comme ceux des «tarfolo» Sénoufo pour la terre, ou des «grandes familles» comme les Gbon Coulibaly à Korhogo. A plusieurs reprises, une articulation avec le «pouvoir coutumier» a évité à la rébellion d’être décimée : en particulier lors de «l’épuration ethnique» de Bouaké (exclusion des populations Baoulé au profit des Dioula) et lors des tentatives, en octobre 2004, pour reprendre la ville, lorsque des vendetta et des règlements de compte entre groupes ethniques prenaient de l’ampleur. Des négociations et des médiations ont empêché in extremis la situation de passer hors de contrôle de la rébellion, de même, lors de massacres réciproques entre partisans de Ib et de Soro en décembre 2003. Pratiques de la violence La violence militaire, criminelle ou politique, en zone rebelle, est mal connue et mal documentée, à tel point que certains observateurs, paraphrasant la formule connue en Occident, prétendent que «les observateurs des Droits de l’Homme sont au Sud, les crimes de guerre au Nord». En termes de gouvernance et de définition de la légitimité de la rébellion, de la cohérence de ses pratiques avec son idéologie, le sujet est pourtant crucial. Le thème de la violence peut cependant se nuancer selon les temps et les lieux : dans sa dimension chronologique, les débuts sont marqués non seulement par la «violence de guerre» contre l’armée ivoirienne, et les autres «corps habillés», mais aussi par des massacres de fonctionnaires et de civils sudistes qui restent à préciser; puis, par une «épuration ethnique» largement sous-évaluée, notamment de la part de la galaxie humanitaire qui collabore avec la rébellion en zone Nord, en particulier dans la ville de Bouaké ; enfin, par un massacre ethnico-factionnel au sein de la rébellion, lors de l’épuration violente par les miliciens de Guillaume Soto – surtout Sénoufo, des partisans d’Ibrahim Coulibaly – en grande partie Malinké :
Monique Mas, sur Rfi, le 3 août 2004.
«L’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire” (Onuci) a découvert trois charniers au Nord de la Côte d’Ivoire, dans la région de Korhogo où se sont rendus par deux fois ses enquêteurs chargés des Droits de l’Homme et de la police, du 1er au 12 juillet et du 22 au 26 juillet derniers. Avant même la publication de leur rapport, les spécialistes onusiens ont annoncé le 2 août qu’ils avaient pu établir la mise à mort, par balles, décapitation ou asphyxie, de quelque 99 personnes au moins. Les corps ensevelis dans trois sites seraient identifiés comme ceux de victimes des affrontements qui ont opposé dans la métropole nordiste des factions rivales de l’ancienne rébellion du Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire (Mpci), les 20 et 21 juin dernier. La victoire était alors revenue à Guillaume Soro, l’actuel chef politique des Forces nouvelles».
Y compris, à l’inverse pour un «maintien de l’ordre» très militaire : en 2003 par exemple…
Cela n’empêche pas une «violence ordinaire» contre la population autochtone, régulière et sanglante, encore plus mal connue, due en particulier à l’absence de forces de l’ordre de l’appareil militaire rebelle et qui devrait conduire à reposer, comme au Congo, en Ouganda, au Liberia, au Sierra Leone, etc, la question de la criminalisation de ce pouvoir et des sanctions juridiques encourues.
A ce propos, une sorte de scène prototypique pour l’opinion ivoirienne pourrait être celle du massacre gratuit, par un groupe de rebelles, de jeunes filles Baoulé exécutant dans un petit village près de Sakassou une danse rituelle d’exorcisme de la violence. Cet épisode mineur, qui a autant touché les imaginations que l’immolation des enfants de gendarmes sudistes de Bouaké, a bien sûr à voir avec la perte d’une certaine innocence du vivre ensemble, du temps des rituels remplacé par celui de la violence pure. Enfin, ce que l’on a pu appeler la «libérianisation» de l’Ouest conduit à des formes de violence plus anomiques, en tout cas proches de celles observées lors du conflit du Liberia, à tel point que la rébellion elle-même s’est débarrassée de leaders comme le «pseudo Doe» et de groupes nomades enfreignant les pratiques de la rébellion de Bouaké, elle-même pourtant peu regardante sur les exactions contre les civils.
D’origine Baoulé, N’Dri N’Guessan alias sergent Félix Doe, a été tué en avril 2003
Ainsi on a pu parler d’«épuration ethnique sporadique» sur plusieurs points de la zone rebelle, en particulier dans les territoires proches du Liberia, contre les Guéré en particulier. Il est vrai que cette «libérianisation» du territoire ivoirien reste partagée, puisque les deux camps – loyaliste et rebelle – ont instrumentalisé à la fois des couples d’oppositions ethniques transfrontalières, depuis longtemps sous-jacents (Gyo/Dan vs Wê/Krahns) et des groupes nomades mercenaires, issus des conflits du Liberia et de la Sierra Leone, et en quelque sorte recomposés pour poursuivre leurs carrières guerrières. L’évolution sanglante de l’Ouest a tellement porté tort à l’ensemble de la rébellion, que le «pseudo Doe», leader éphémère de l’inconsistant Mpigo, a vraisemblablement été exécuté par les partisans de Guillaume Soro.
Dans la «capitale rebelle», Bouaké, il semble que les pratiques des groupes militaro-mafieux, de type «Camorra», «Cosa nostra» et autres «Ninja», qu’a connu Abidjan sous la dictature militaire du Général Gueï, restent les mêmes. Cela n’étonne aucun analyste, tant il est connu qu’un groupe des «fondateurs» de la rébellion est justement issu de cette mouvance. Selon une enquête de la Ligue des Droits de l’Homme ivoirienne (Lidho) de février 2003, «environ 80 % des violences sont perpétrées par les rebelles» : il faut bien dire que l’image qu’en donnent les médias français et une certaine recherche politologique ne l’a guère évoqué… Comme nous l’avons signalé, les enquêtes villageoises en particulier restent à faire dans la zone Nord. Depuis plusieurs années, les Ong françaises de terrain, telles Acf, remarquent que la violence systématique contre les populations civiles de l’Ouest sont très sous-estimées. Il faut y voir la conjugaison d’incursions libériennes et de pratiques extrêmes, qui échappent en partie au (contre-) pouvoir de Bouaké, avec une criminalisation des forces en présence, aggravée par un système de représailles non seulement interethniques (inter-ivoirien), mais avec les immigrants nordistes au sens large («Dioula» sahéliens) dans une compétition foncière aiguë.
Michel Galy politologue,
chercheur au Centre sur les conflits et animateurs de la revue «Culture et conflits».